Autour d'un roman : Diên Biên Phù - Rencontre avec Marc Alexandre Oho Bambe [Partie 1]
Diên Biên Phù, joli coup de foudre littéraire dont je vous parlais il y a peu sur le blog (chronique ici). Mais en refermant le premier roman de Marc Alexandre Oho Bambe paru aux éditions Sabine Wespieser, plusieurs questions me trottaient dans la tête auxquelles Marc Alexandre a accepté de répondre.
Diên Biên Phù, joli nom pour une rencontre chaleureuse avec l’auteur le 10 mai dernier dans un des plus jolis cafés de Lille. Un grand merci (Na som jita) à Marc Alexandre pour sa disponibilité et la richesse de ce moment mais aussi à Sandrine Constant, son agent, qui a rendu possible cette rencontre.
L'interview étant dense, elle paraîtra en deux parties. Je vous propose de démarrer par le Off du roman.
Vous avez choisi comme trame de fond la guerre d’Indochine. Une occasion pour vous d'aborder la colonisation, la tolérance, l'oppression.
Vous avez choisi comme trame de fond la guerre d’Indochine. Une occasion pour vous d'aborder la colonisation, la tolérance, l'oppression.
Pourquoi cette guerre plutôt qu'une autre ?
Parce que Diên Biên Phù a marqué le début du déclin de l’empire colonial français.
En parlant de Diên Biên Phù, entre les lignes finalement je parle aussi des raisons qui ont soulevé l’Algérie, puis les pays d’Afrique Subsaharienne pendant les années 60 au moment de indépendances, les peuples colonisés menaient combat contre l’impérialisme avec le sentiment qu’ils pouvaient gagner.
Et quand j’étais plus jeune beaucoup de rappeurs que j’écoutais évoquaient dans leurs chansons la résistance par cette image « avoir un mental de viêt », j’ai compris plus tard ce que ça voulait dire et à quoi ça faisait référence : la guerre d’Indochine perdue par la France, ensuite la guerre du Vietnâm que les américains ont perdu également. Il y avait quelque chose qui fascinait chez ce peuple vietnamien, dont la résistance, l’héroïsme étaient une leçon pour tous les peuples opprimés.
Diên Biên Phù aussi juste pour la musique, la musique du nom de cette ville, musique qui me saisit et m’interpelle depuis l’âge de seize ans, avant même que je sache ce qui s’y était passé. Diên... Biên... Phù… pour moi il y a une musique absolue dans ces trois syllabes, un son qui claque.
Cela avait du sens, d’aborder la colonisation et les luttes de décolonisation, la résistance et l’engagement, à partir de cette ville symbolique. En parlant du Vietnam je parle du Cameroun, de l’Algérie, je parle d’ailleurs aussi de la France, et de la résistance au nazisme d’une certaine manière. En fait à partir de Diên Biên Phù, je peux parler de tous les pays, tous les peuples du monde qui se sont rebellés contre un système basé sur la violence, la déshumanisation de l’autre, la destruction des identités, afin de se réapproprier leurs destinées.
En parlant de Diên Biên Phù, entre les lignes finalement je parle aussi des raisons qui ont soulevé l’Algérie, puis les pays d’Afrique Subsaharienne pendant les années 60 au moment de indépendances, les peuples colonisés menaient combat contre l’impérialisme avec le sentiment qu’ils pouvaient gagner.
Et quand j’étais plus jeune beaucoup de rappeurs que j’écoutais évoquaient dans leurs chansons la résistance par cette image « avoir un mental de viêt », j’ai compris plus tard ce que ça voulait dire et à quoi ça faisait référence : la guerre d’Indochine perdue par la France, ensuite la guerre du Vietnâm que les américains ont perdu également. Il y avait quelque chose qui fascinait chez ce peuple vietnamien, dont la résistance, l’héroïsme étaient une leçon pour tous les peuples opprimés.
Diên Biên Phù aussi juste pour la musique, la musique du nom de cette ville, musique qui me saisit et m’interpelle depuis l’âge de seize ans, avant même que je sache ce qui s’y était passé. Diên... Biên... Phù… pour moi il y a une musique absolue dans ces trois syllabes, un son qui claque.
Cela avait du sens, d’aborder la colonisation et les luttes de décolonisation, la résistance et l’engagement, à partir de cette ville symbolique. En parlant du Vietnam je parle du Cameroun, de l’Algérie, je parle d’ailleurs aussi de la France, et de la résistance au nazisme d’une certaine manière. En fait à partir de Diên Biên Phù, je peux parler de tous les pays, tous les peuples du monde qui se sont rebellés contre un système basé sur la violence, la déshumanisation de l’autre, la destruction des identités, afin de se réapproprier leurs destinées.
Et pour autant, vous y abordez aussi l’Afrique à travers le personnage de Diop qui est sénégalais et qui a une place importante dans le récit. Vous est-il inspiré d’une personne que vous connaissez ?
C’est quelqu’un que je connais, oui. Le personnage de Diop m’a été inspiré par plusieurs personnes. La sagesse de Diop c’est un peu celle de mon grand-père qui quand nous étions enfants, à Douala où je suis né et où j’ai grandi, nous parlait souvent en paraboles, il parlait aux gens avec des images fortes, il avait toujours un mot comme un viatique pour poursuivre le voyage de vivre. Et je me souviens, lorsque mon père a décidé que j’allais poursuivre mes études en France, la veille de mon départ mon grand-père m’a offert ces paroles, reprises plus tard dans un de mes textes, que je slame souvent – « pars à l’étranger comme tu vas chez un ami et chez ami comme tu pars à l’étranger, avec toujours la même soif d’altérité et la même faim insatiable du monde ».
Diop a aussi un peu cette manière d’être au monde et de partager, parler de choses profondes avec des phrases simples qui nous disent qui nous sommes ou qui nous pouvons être.
Mon grand-père, assis dans sa véranda, agissait ainsi, et il y a dans ce don, toute une part d’Afrique qui me constitue et que je continue à ma manière.
Diop a aussi un peu cette manière d’être au monde et de partager, parler de choses profondes avec des phrases simples qui nous disent qui nous sommes ou qui nous pouvons être.
Mon grand-père, assis dans sa véranda, agissait ainsi, et il y a dans ce don, toute une part d’Afrique qui me constitue et que je continue à ma manière.
L'amour, l'amitié mais aussi la mort ou la mort vivante sont au centre du voyage de votre héros. Comme une sorte de pèlerinage où l’on oscille entre flashback et présent. Comment avez-vous construit ce récit pour lui imposer cette fluidité ?
Il n’y a pas eu de construction dans le roman. Je savais que je voulais raconter, depuis très longtemps, une histoire d’amour au long court, une de ces histoires d’amour dont on ne se relève pas : Layla et Majnûn, Tristan et Iseut… la forme romanesque était essentielle pour y arriver.
Je voulais aussi questionner la colonisation. Et puis je voulais parler d’amitié, valeur essentielle à mes yeux, car j’ai le bonheur d’avoir des amitiés inconditionnelles qui m’ont sauvé la vie.
Je pense que je voulais, d’une certaine manière, rendre hommage à mes amis de plus de trente ans.
Après je suis parti à l’aveugle, j’avais beaucoup de doutes, d’appréhensions quand j’ai commencé le texte car lorsque je me relisais j’avais l’impression de m’entendre slamer, ce qui m’a un peu inquiété (rires). Mais mon éditrice m’a rassuré et totalement libéré avec ces mots : « il ne faut pas que tu tentes d’être quelqu’un d’autre dans l’écriture de ton roman. Tu es poète fondamentalement et il faut que tu restes toi-même », à partir du moment où elle me l’a dit – comme c’est une éditrice dont j’admire le travail – je ne me suis plus posé de questions. Je me suis laissé aller. Je me suis abandonné complètement corps, cœur et âme dans ce texte. Les personnages à un moment ont pris le dessus et c’est eux qui décidaient, presque de tout. J’ai connu ces moments de jubilation où on a hâte de retrouver ses personnages, parce qu’ils ne nous quittent pas, ne nous lâchent pas. Mes personnages m’ont imposé de m’arrêter, tout arrêter pour terminer mon livre. J’ai ressenti l’urgence d’aller au bout de l’histoire. En tournée aux Comores, j’ai pris une semaine de plus pour rester sur une île, ne rien faire d’autre que regarder le soleil se lever et se coucher et entre les deux écrire et aller pêcher avec les hommes du village. Quand je suis rentré à Lille, au lieu de vivre chez moi, je dormais à l’hôtel car je voulais être dans la peau d’Alexandre, mon narrateur qui vit à l’hôtel, dans un entre-deux. Je n’avais même plus l’impression d’écrire, c’est le roman qui s’écrivait en moi. C’est un roman qui a surgi de mes tripes. Mélange d’instinct, d’intuitions et d’envies, de rêves qui se matérialisent.
Je voulais aussi questionner la colonisation. Et puis je voulais parler d’amitié, valeur essentielle à mes yeux, car j’ai le bonheur d’avoir des amitiés inconditionnelles qui m’ont sauvé la vie.
Je pense que je voulais, d’une certaine manière, rendre hommage à mes amis de plus de trente ans.
Après je suis parti à l’aveugle, j’avais beaucoup de doutes, d’appréhensions quand j’ai commencé le texte car lorsque je me relisais j’avais l’impression de m’entendre slamer, ce qui m’a un peu inquiété (rires). Mais mon éditrice m’a rassuré et totalement libéré avec ces mots : « il ne faut pas que tu tentes d’être quelqu’un d’autre dans l’écriture de ton roman. Tu es poète fondamentalement et il faut que tu restes toi-même », à partir du moment où elle me l’a dit – comme c’est une éditrice dont j’admire le travail – je ne me suis plus posé de questions. Je me suis laissé aller. Je me suis abandonné complètement corps, cœur et âme dans ce texte. Les personnages à un moment ont pris le dessus et c’est eux qui décidaient, presque de tout. J’ai connu ces moments de jubilation où on a hâte de retrouver ses personnages, parce qu’ils ne nous quittent pas, ne nous lâchent pas. Mes personnages m’ont imposé de m’arrêter, tout arrêter pour terminer mon livre. J’ai ressenti l’urgence d’aller au bout de l’histoire. En tournée aux Comores, j’ai pris une semaine de plus pour rester sur une île, ne rien faire d’autre que regarder le soleil se lever et se coucher et entre les deux écrire et aller pêcher avec les hommes du village. Quand je suis rentré à Lille, au lieu de vivre chez moi, je dormais à l’hôtel car je voulais être dans la peau d’Alexandre, mon narrateur qui vit à l’hôtel, dans un entre-deux. Je n’avais même plus l’impression d’écrire, c’est le roman qui s’écrivait en moi. C’est un roman qui a surgi de mes tripes. Mélange d’instinct, d’intuitions et d’envies, de rêves qui se matérialisent.
 |
| © Rue des Archives |
Vous auriez pu utiliser la poésie simplement dans la construction de vos phrases or vous avez le choix de vraiment intégrer des poèmes.
Oui car ils s’adressent à l’absente. Je me suis dit : Alexandre rentre vingt ans en France, cette femme est restée au Vietnam, il est toujours complètement amoureux d’elle, comment fait-il pour la garder avec lui pendant vingt ans ? Comment fait-on pour garder un être qui n’est pas là pendant vingt ans ? On lui écrit, c’est le seul moyen d’entendre sa voix, d’avoir le sentiment qu’elle lit ce qu’on écrit. C’est le seul moyen de ne pas la perdre de vue.
C’était donc important que ces mots-là soient en dehors du texte pour qu’on puisse les ressentir aussi.
C’était donc important que ces mots-là soient en dehors du texte pour qu’on puisse les ressentir aussi.
Je reviens sur une chose que vous avez dite, vous parliez des liens d’amitié, fort, inaltérables, vous avez dit qu’ils vous avez sauvé. C’est une chose que l’on ressent dans votre roman, ces liens qui peuvent sauver, changer les hommes. Et en même temps, vous semblez dire également – dites-moi si je me trompe – que l’homme échoue aussi parce qu’il est justement un homme. Alors, qu’en est-il ?
Les Hommes peuvent sauver les Hommes, j’y crois. D’ailleurs je dis souvent en plaisantant que « je crois en l’homme parce qu’il a inventé la poésie », la poésie sauve, les mots sauvent et les mots ne viennent pas de nulle part, ils viennent de femmes, d’hommes, de chair, de sang, de cœur et d’âme. Et ces femmes et ces hommes peuvent sauver. L’amitié ou l’amour aussi sont des sentiments qui peuvent sauver, qui sauvent et qui élèvent au-dessus de nous-même, nous font nous sentir plus grands que nous, plus grands que tout. Et en même temps, oui les hommes échouent non pas parce qu’ils sont des hommes mais parce qu’ils ne sont que des hommes. Et ça j’y crois aussi, on échoue parfois parce qu’on n’est que des hommes ou que des femmes, humains de toutes nos forces et nos faiblesses. On s’élève alors, on se relève en cessant de n’être qu’un homme ou qu’une femme justement, et à ce moment-là on peut toucher à la grâce, dans les relations avec les autres, dans la vie, dans la poésie, dans tout ce qui peut nous permettre de respirer ensemble. À deux, à plusieurs. De manière collective.
“ Bousculés
Nous basculons schizophrènes
De l'autre côté de l'amer
Nous sommes les mêmes ”
Alors, autre personnage… Il y a une fille, dans un taxi, qui joue un rôle essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, car finalement elle est assez mystérieuse…
La fille du taxi, est un miracle aussi, elle permet à mon narrateur Alexandre de se raconter. Sans elle, il ne peut pas se raconter, sans elle le livre n’existe pas. Elle est juste peinte, mais elle a une place centrale.
Il y a cette notion de collectif qui revient.
Oui toujours, toujours en réalité. La notion de « relation » chère à Edouard Glissant, et que je trouve magnifique : « je peux changer en échangeant avec l’autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer ». J’y crois de manière profonde, sincère, absolue depuis mes plus jeunes années et Diên Biên Phù est un livre sur la guerre, la mort, la vie, l’amour, l’amitié, mais aussi la relation : amoureuse, complexe Mireille/Alexandre, absolue Alexandre et Maï Lan, amicale, radicale, définitive, fraternelle Alexandre et Alassane Diop ; la relation à cette jeune femme mystérieuse, la fille du taxi, qui finalement est un peu celle qui accouche Alexandre une seconde fois, parce qu’elle lui permet de se raconter. On a toujours besoin d’une écoute, une oreille, une épaule, quelqu’un d’autre que nous.
Et est-ce qu’elle n’est pas un peu aussi l’espoir finalement d’Alexandre ?
Si, elle l’est mais elle est à la fois son espoir et celle qui le reconnecte à lui-même. Écrire, finalement ce n’est rien d’autre que prendre de ses nouvelles et Alexandre a passé des années dans une forme de mutisme, parole close, à vivre, à essayer de vivre, à être un autre. Et quand il revient au Vietnam, rencontrer cette fille libère sa parole. Ça le libère complètement. Il est revenu dans le doute, sans savoir s’il avait une chance de retrouver Maï Lan, mais il est revenu pour faire la paix avec lui-même, mourir en paix. C’est le sens de sa quête. La fille du taxi, qui lui dit « j’ai envie de t’aider à retrouver ton cœur », est essentielle dans cette quête. Absolument.
Il y a quelque chose de pur, de la grâce dans leur relation et le regard qu’elle porte sur Alexandre, c’est presque aussi fort que le regard qu’Alexandre porte Maï Lan.
Je trouve aussi et c’est un personnage qui m’émeut beaucoup parce qu’effectivement dans la manière de regarder Alexandre, de décider comme de l’aider, chercher à savoir qui il est et pourquoi il est au Vietnam, continuer à l’accompagner et lui dire « ta quête et aussi la mienne », il y a quelque chose de très beau et très émouvant. C’est quelqu’un qui entre dans la vie d’Alexandre et qui lui permet de sourire à nouveau. « Jusqu’à quelle heure peut-on être innocent ? », elle le touche beaucoup avec ses questions, son aplomb, sa manière d’être au monde. Et c’est quelqu’un qui me touche beaucoup aussi.
Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour découvrir la suite de l'interview autour de l'auteur cette fois-ci.



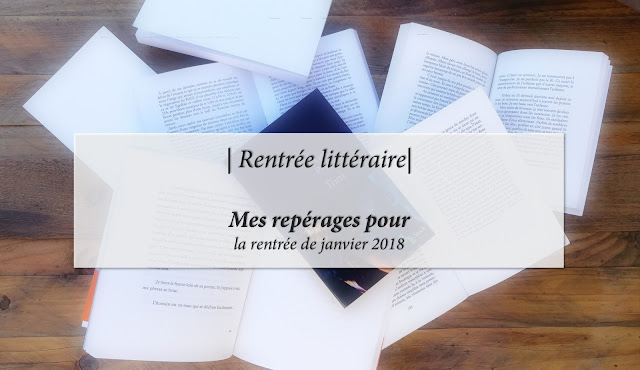


Commentaires
Enregistrer un commentaire